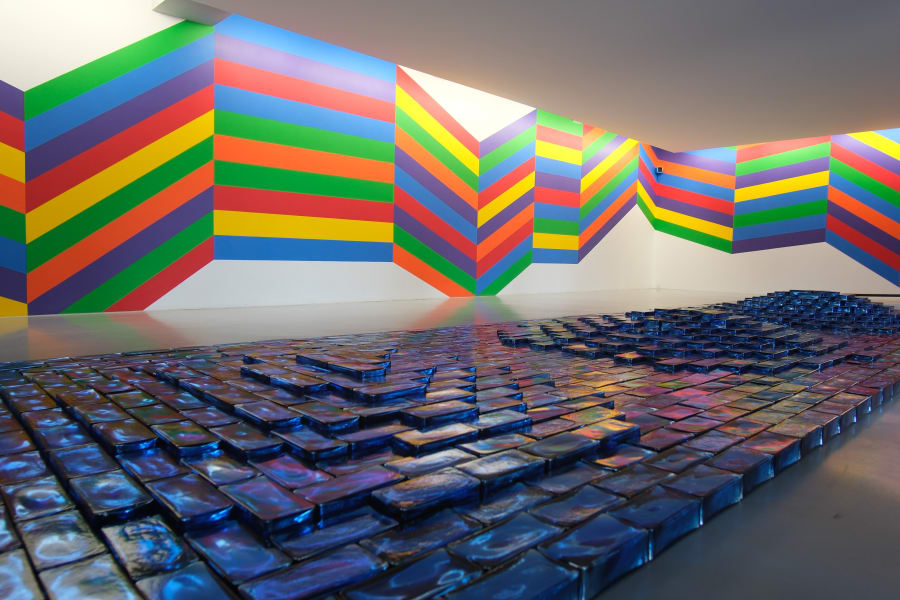De son lit, installé en diagonale dans sa chambre au premier étage, Jean Cocteau aperçoit le ciel et les deux grosses tours d’un château médiéval. Cocteau avait coutume de dire : « À Milly, j’ai découvert un cadre. » Un cadre « comme au cinéma, probablement », précise Muriel Genthon, directrice de la Maison Jean Cocteau à Milly-la-Forêt, dans le département de l'Essonne, à environ 60 kilomètres de Paris. La maison, où Jean Cocteau avait l’habitude de se retirer de la vie parisienne entre 1947 et sa mort en 1963, abrite aujourd'hui un musée qui lui est consacré. Alors que son œuvre a longtemps été cantonnée au champ de la littérature, sa personnalité polymorphe, la façon dont il a mêlé l’écriture, le dessin, le cinéma et le goût de la scène, sont peut-être à l’origine du regain d’intérêt dont il semble aujourd’hui faire l’objet – comme en témoigne par exemple l’installation d’Ali Cherri dans les vitrines de la Bourse de Commerce en 2025, inspirée du film Le Sang d’un poète (1932).
C’est l'acteur Jean Marais, avec qui Cocteau vit une histoire d’amour passionnelle, qui découvre pour lui la maison de Milly. La maison est entourée de bras d’eau dérivés des anciennes douves du château et d’un verger où poussent les pommes et les poires. « L’atmosphère est celle de son film La Belle et la Bête (1946) » ajoute encore Muriel Genthon, en montrant Le Turc, un buste qui orne le devant de la maison, offert à Cocteau par Christian Bérard, peintre et décorateur du film. Une photographie, récemment acquise par l’institution, montre d’ailleurs Cocteau, debout à côté de cette sculpture, dans le peignoir blanc qu’il affectionnait. Deux sphinges encadrent le perron ; l’une d’elles porte le visage de Madame du Barry, la célèbre courtisane de Louis XV.
Cocteau aimait les objets. L’intérieur de la maison en témoigne, d’une intimité singulière. « On raconte que son amie Madeleine Castaing a mis sa patte dans la décoration de la maison », affirme encore Muriel Genthon. Le goût de cette antiquaire de Saint-Germain-des-Prés, qui avait un magasin au coin de la rue Jacob et de la rue Bonaparte, apparaît en effet dans les rideaux de velours rouge, les murs recouverts de léopard, la sirène de manège en guise de porte-manteau, la dent de narval chinée en Espagne, la boîte en patte de rhinocéros, les palmiers dorés, le jazzman automate offert par Jean Marais, la grue chinoise des années 1950, le moulage de ses longues mains, le fauteuil de l'écrivain André Gide, l’autre fauteuil en corne de buffle et en fourrure, le tableau en relief d’une montgolfière prise dans la tempête, la selle de chameau dont les pieds sont des épées…
Cocteau travaillait partout, sur les nombreuses tables, dans son lit, et même sur le sol. Ici et là sont posés des livres comme Le Diable au corps (1932) de Raymond Radiguet, jeune écrivain qu’il a follement aimé, des pipes à opium, et de quoi écrire et dessiner, encres et feutres américains anciens – de l’époque où il n’en existait pas en France. Des photos sont accrochées, ainsi que des collages de Jean Harold : la tête de Picasso sur le buste d’une Ménine de Velázquez, ou celle de Sartre sur le corps d’un pape.
Plusieurs objets comme les faons en bronze, copies d’antiques qui entourent la cheminée, ont été offerts à Cocteau par Francine Weisweiller, l’un·e de ses mécènes et de ses grand·e·s ami·e·s, que l’on aperçoit sur plusieurs photographies. C'est pour elle qu'il a réalisé des fresques a tempera dans sa maison de Saint-Jean-Cap-Ferrat, dans le Sud de la France. « Santo Sospir est une villa tatouée », disait-il en évoquant la façon dont il a travaillé pendant l'été 1950, sur des échelles, sans croquis préparatoire, au fusain, avec des poudres de couleur délayées dans du lait cru. Cette technique artisanale, presque primitive, contrastait avec l'élégance raffinée du lieu.
Construite en 1931, la maison avait été décorée par Madeleine Castaing, dont le goût en matière de décoration d’intérieur était alors incontournable. Alors qu’il séjournait là pour quelques jours seulement, tout a commencé lorsque Cocteau a demandé à Francine Weisweiller s’il pouvait dessiner une simple tête d’Apollon sur un mur du salon. Puis son trait a envahi toutes les pièces, débordant des murs jusqu’aux plafonds, entre dessin et écriture, dans une atmosphère onirique et érotique qui transformait chaque espace en théâtre de ses obsessions. La maison apparaît dans son film Le Testament d’Orphée (1960), immortalisant ces créations murales dans son œuvre cinématographique. Cocteau y est souvent retourné par la suite. Aujourd’hui, la maison reste fermée au public, et conserve le secret du dialogue entre Cocteau et ce lieu.
Depuis la disparition de Cocteau en 1963, Édouard Dermit - son fils adoptif, un peintre, ayant joué dans Les Enfants terribles (1950) - a hérité de la maison de Milly. Il a décidé d’en faire un musée. Puis après sa mort, Pierre Bergé l’a achetée, y a mené d’importants travaux jusqu’à l’ouverture du musée en 2010. La revente de la maison a donné lieu à la création d’un groupement d’intérêt public (GIP), constitué de la région Île-de-France, du département de l’Essonne, de la ville de Milly-la-Forêt et du Centre Pompidou. Aujourd’hui, la Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent demeure parmi les principaux prêteurs des œuvres exposées, comme le portrait de Cocteau par Marie Laurencin réalisé en 1921.
En 1959, les élus de Milly-la-Forêt passent commande à Cocteau d’un décor pour orner la petite chapelle du village, Saint-Blaise-des-Simples, une ancienne maladrerie. Il avait déjà réalisé la chapelle des pêcheurs à Villefranche-sur-Mer, la salle des mariages de la mairie de Fréjus et l’église Notre-Dame-de-France à Londres. Au dernier étage de la maison, une riche exposition présente de nombreux dessins préparatoires, des films documentant l’inauguration des lieux et sa restauration récente.
Cette petite chapelle du 12e siècle, que Cocteau a décorée est également devenue son lieu de sépulture. Tout autour de sa tombe, l’iconographie se compose de dessins de hautes plantes médicinales qui semblent léviter au-dessus des murs, et d’une Ascension du Christ au-dessus de l’autel. Dans ses dessins au trait limpide, on retrouve toute la fantaisie de l'artiste. La main du Christ est curieusement auréolée. Pourquoi ? « Pour faire parler les gens ! », aurait répondu Cocteau.
Anaël Pigeat est critique d’art, editor-at-large pour le mensuel The Art Newspaper, journaliste pour Paris Match et commissaire d’exposition basée à Paris.
Légende de l’image d’en-tête : La maison de Jean Cocteau à Milly-la-Forêt, dans la région Île-de-France. Photographie de Laurence Godart.
Publié le 24 juillet 2025.